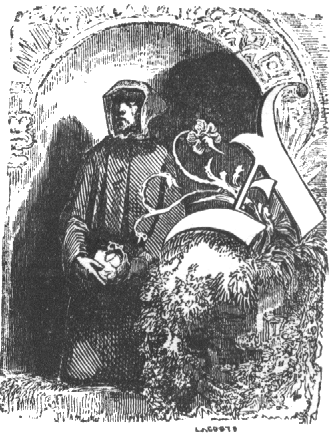 NCIENNEMENT
elle s'appelait la rue das Estubos ou das Caoudanos ; elle est
bordée de l'un et de l'autre côté par de très vieilles
maisons, au-dessous desquelles surgissent, de nombreuses sources d'eaux thermales.
Dans plusieurs caves de ces maisons, sont des bains antiques dont la construction
romaine ne saurait être révoquée en doute. Le docteur Robert,
auteur d'un Essai historique et médical sur les eaux de Sextius,
est le premier qui ait parlé de ces bains, et l'on peut voir ce qu'il
en dit dans son ouvrage. 1
Une de ces maisons fut vendue, en 1567, par les consuls, au nom de la ville,
à un nommé Guigon Mayne qui, suivant tontes les apparences, y
fit construire des bains publics. Le médecin Lauthier, écrivant
en 1705, son Histoire naturelle des eaux chaudes d'Aix, 2
atteste, en effet, que suivant la tradition de cette époque, il n'y avait
pas plus de cent cinquante ans, que les eaux du quartier de l'Observance servaient
à faire des bains, et Pitton, qui publia en 1678, son traité intitulé
les Eaux chaudes de la ville d'Aix, 3
est le premier auteur qui ait employé à leur égard le nom
de Mayne. Tout nous paraît donc concourir à attribuer à
ce Guigon Mayne, l'origine du nom vulgaire donné à ces bains publics,
et continué ensuite jusqu'à ce jour aux nouveaux bains que la
ville fit construire en 1705, à quelques pas de là et qu'on nomme
aussi les bains de Sextius. On peut lire dans l'Essai historique et médical,
ci-dessus cité, 4
ce que nous écrivions alors au docteur Robert, qui adopta sans difficulté
notre étymologie, laquelle s'est depuis changée en certitude historique
sous la plume de notre savant bibliothécaire, M. Rouard, dans sa Notice
sur la bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes. 5
La rue des Etuves aboutit, du côté du nord, à une place
au devant de laquelle se trouvait l'église de l'Observance, bâtie
en 1466, et qui a été détruite pendant la révolution,
ainsi que le couvent des religieux Observantins. Cette église n'offrait
rien de bien remarquable, sinon qu'elle renfermait, plus qu'aucune autre un
bon nombre de sépultures d'anciennes familles de la ville, nobles ou
bourgeoises. Le grand Palamède de Forbin, mort en 1508, y était
enterré, de même que le premier président Jean Maynier d'Oppède,
l'exécuteur de l'arrêt rendu contre les hérétiques
de Cabrières et de Mérindol, mort en 1558 ; le premier président
Jean-Augustin de Foresta, mort en 1588 ; François de Clapiers, seigneur
de Vauvenargues et du Sambuc, mort la même année que le précédent,
le premier auteur qui ait fait imprimer une histoire des comtes de Provence.
6 Nous rappellerons
aussi le président François de Perussis, baron de Lauris, mort
en 1587, et qui voulut être enseveli dans cette église, dans un
tombeau antique en marbre, qu'il avait fait venir d'Arles, et sur lequel sont
sculptés un grand nombre de personnages représentant les Israélites
passant la mer Rouge. Ce tombeau est aujourd'hui au Musée. Dans la chapelle
où il était placé à gauche du grand autel, on voyait
deux tableaux sur bois qui servaient de portes au tableau de l'autel. Sur l'un
était représenté ce président de Perussis, et sur
l'autre le premier président d'Oppède, son beau-père, duquel
nous venons de parler. Celui-ci était peint à genoux. Ces portraits
ont disparu lors de la destruction de l'église.
NCIENNEMENT
elle s'appelait la rue das Estubos ou das Caoudanos ; elle est
bordée de l'un et de l'autre côté par de très vieilles
maisons, au-dessous desquelles surgissent, de nombreuses sources d'eaux thermales.
Dans plusieurs caves de ces maisons, sont des bains antiques dont la construction
romaine ne saurait être révoquée en doute. Le docteur Robert,
auteur d'un Essai historique et médical sur les eaux de Sextius,
est le premier qui ait parlé de ces bains, et l'on peut voir ce qu'il
en dit dans son ouvrage. 1
Une de ces maisons fut vendue, en 1567, par les consuls, au nom de la ville,
à un nommé Guigon Mayne qui, suivant tontes les apparences, y
fit construire des bains publics. Le médecin Lauthier, écrivant
en 1705, son Histoire naturelle des eaux chaudes d'Aix, 2
atteste, en effet, que suivant la tradition de cette époque, il n'y avait
pas plus de cent cinquante ans, que les eaux du quartier de l'Observance servaient
à faire des bains, et Pitton, qui publia en 1678, son traité intitulé
les Eaux chaudes de la ville d'Aix, 3
est le premier auteur qui ait employé à leur égard le nom
de Mayne. Tout nous paraît donc concourir à attribuer à
ce Guigon Mayne, l'origine du nom vulgaire donné à ces bains publics,
et continué ensuite jusqu'à ce jour aux nouveaux bains que la
ville fit construire en 1705, à quelques pas de là et qu'on nomme
aussi les bains de Sextius. On peut lire dans l'Essai historique et médical,
ci-dessus cité, 4
ce que nous écrivions alors au docteur Robert, qui adopta sans difficulté
notre étymologie, laquelle s'est depuis changée en certitude historique
sous la plume de notre savant bibliothécaire, M. Rouard, dans sa Notice
sur la bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes. 5
La rue des Etuves aboutit, du côté du nord, à une place
au devant de laquelle se trouvait l'église de l'Observance, bâtie
en 1466, et qui a été détruite pendant la révolution,
ainsi que le couvent des religieux Observantins. Cette église n'offrait
rien de bien remarquable, sinon qu'elle renfermait, plus qu'aucune autre un
bon nombre de sépultures d'anciennes familles de la ville, nobles ou
bourgeoises. Le grand Palamède de Forbin, mort en 1508, y était
enterré, de même que le premier président Jean Maynier d'Oppède,
l'exécuteur de l'arrêt rendu contre les hérétiques
de Cabrières et de Mérindol, mort en 1558 ; le premier président
Jean-Augustin de Foresta, mort en 1588 ; François de Clapiers, seigneur
de Vauvenargues et du Sambuc, mort la même année que le précédent,
le premier auteur qui ait fait imprimer une histoire des comtes de Provence.
6 Nous rappellerons
aussi le président François de Perussis, baron de Lauris, mort
en 1587, et qui voulut être enseveli dans cette église, dans un
tombeau antique en marbre, qu'il avait fait venir d'Arles, et sur lequel sont
sculptés un grand nombre de personnages représentant les Israélites
passant la mer Rouge. Ce tombeau est aujourd'hui au Musée. Dans la chapelle
où il était placé à gauche du grand autel, on voyait
deux tableaux sur bois qui servaient de portes au tableau de l'autel. Sur l'un
était représenté ce président de Perussis, et sur
l'autre le premier président d'Oppède, son beau-père, duquel
nous venons de parler. Celui-ci était peint à genoux. Ces portraits
ont disparu lors de la destruction de l'église.Voici quelles étaient les principales familles qui avaient leur tombeau à l'Observance et qui, presque toutes, avaient fourni des personnages de mérite : les Aquillenqui, les Aimar, barons de Châteaurenard, les Albertas seigneurs de Gémenos, marquis de Bouc, etc., les Albi, seigneurs de Bresc, les Albinot et les Alpheran ; les Anglès ou Anglesy, les Arbaud, seigneurs de Jouques, de Gardanne, etc., et les Audiffredi; les Baldoni, les Ballon, seigneurs de Saint-Julien, les Barcillon, seigneurs de Mauvans, les Barthélemi, seigneurs de Sainte-Croix , et les Beaufort; les Beauregard, les Becarris, les Benault-Lubières, marquis de Roquemartine, les Bezieux, les Billon, les Bougerel et les Broglia; les Cadenet, seigneurs de Charleval , etc. , les Caissan et les Cipières ; les Clapiers, seigneurs de Vauvenargues, etc. , les Colla, les Constans, les Dubourg et les Estienne, seigneurs du Bourguet ; les Feraporte , les Forbin ( Janson , la Barben d'Oppède, Sainte-Croix et Soliès), les Foresta, seigneurs de Rougiers, marquis de la Roquette, etc.; les Gaillard-d'Agoult et de Longjumeau , les Garçonnet et les Garidel ; les Gueidan seigneurs de Valabre, marquis de Gueidan, etc., les Guerre, les Hélie et les d'Hupaïs; les Jujardi, les Issaurat et les Julianis; les Malespine, les Manosque, les Mazargues, les Mimata, les Mine et les Montaud ; les Ollioules, les Paule, les Pellicot, seigneurs de Saint-Paul, et les Rascas, seigneurs de Châteauredon et du Canet ; les Redortier, les Rians, les Roboli et les Roquebrune ; les Simon, les Trest, les Tributiis, seigneurs de Sainte-Marguerite, les Vinaud et les Vivaut.
M. François Alpheran, notre aïeul maternel, ancien garde du corps de Louis XV, mort en 1795, et descendant de l'une de ces familles, apprenant, en 1776, que le roi Louis XVI venait de prohiber les inhumations dans les églises, poussa aussitôt des cris de fureur, et alla jusqu'à dire QUE LE PRINCE QUI LUI ENLEVAIT LA CONSOLATION DE PENSER QUE SES CENDRES IRAIENT SE MÊLER A CELLES DE SES PERES, NE REPOSERAIT PAS LUI-MÊME, APRES SA MORT, AUPRES DE SES AUGUSTES ANCÊTRES. Effrayante prophétie qui s'accomplit dans moins de dix-sept ans, et à laquelle se rattachent de si douloureux souvenirs !!!
Dans notre enfance, nous avons entendu parler cent et cent fois de cette terrible prédiction de notre aïeul, à laquelle nous n'attachions alors aucune importance. Les événements de 1789 et 1790 furent cause qu'on en parla encore plus souvent dans la famille, et lors de l'exécrable attentat du 21 janvier 1793, nous étions en âge de comprendre et de mesurer toute la portée de cette prédiction. Bien des gens en eurent connaissance dans le temps, notamment M. de Gabriel, ancien conseiller au parlement, avec qui nous en avons causé fort souvent depuis lors et qui partageait les idées et les regrets de notre aïeul à l'égard de leurs tombeaux de famille qui se trouvaient dans cette même église de l'Observance. Le malheureux Louis XVI aurait pu en effet se borner à interdire les tombes communes qui offraient vraiment du danger pour la santé publique, chacun pouvant s'y faite enterrer et ces tombes se rouvrant presque tous les jours ; il aurait pu prohiber la construction de nouvelles tombes dans quelque cas que ce fût, mais il devait, selon nous, laisser subsister celles des familles alors existantes, jusqu'à l'extinction de ces familles ou leur transmigration dans un autre pays. Mais sous Louis XVI, commençait le goût des innovations. Il fallait réformer, faire du neuf et l'on a vu jusqu'où nous a conduit cette dangereuse manie.
En face de l'église de l'Observance, est située une tour fort élégante construite vers le milieu du XIVe siècle, lorsque la ville fut agrandie de ce côté, et qui fait partie du mur d'enceinte.
Elle est nommée Tourreluco dans les anciens contrats de la ville, parce qu'en temps de guerre, on plaçait des sentinelles au-dessus, pour avertir de l'approche de l'ennemi. Cette tour est parfaitement conservée et mérite de l'être. En 1455, elle fut vendue à Mitrone de Rocca ou de la Roque, père du vénérable fondateur de l'hôpital Saint-Jacques, et passa depuis à Guillen Salvatoris, consul d'Aix en 1531-1532 ; mais la communauté la reprit plus tard et en fit son magasin de munitions de guerre. Pendant la révolution on y conservait la poudre à canon, ce qui a continué jusqu'à la construction de la nouvelle poudrière bâtie, il y a environ vingt ans, sur la route de Marseille, à mi-chemin de la sortie de la ville au Pont-de-l'Arc.
A quelques pas au levant de l'église des religieux Observantins et le long de la lice qui conduit de Tourreluco à la rue des Guerriers, était située, en face du rempart, la chapelle des pénitents Blancs, dits de l'Observance, pour les distinguer des Pénitents Blancs, dits des Carmes. Cette chapelle, détruite pendant la révolution, était ornée de fort belles peintures, notamment d'un plafond de forme ovale, représentant la Résurrection, ouvrage de Jean Daret.
Ce qu'on remarquait de plus précieux dans cette chapelle était un bas-relief en marbre représentant Notre-Dame-de-pitié, sous la forme de la Vierge tenant Notre Seigneur mort sur ses genoux. Ce bas-relief, d'environ 4 pieds de haut sur 3 de large et qu'on attribuait à Michel-Ange avait été donné aux pénitents vers 1565, par le second comte de Tende, Claude de Savoie gouverneur de Provence qui avait été recteur de la confrérie. Son portrait se voyait dans une des salles attenantes à la chapelle, ainsi que ceux de René de Savoie, son père, et d'Honoré de Savoie, son fils, l'un et l'autre comtes de Tende et gouverneurs de Provence, qui avaient été aussi recteurs de ces pénitents. Ces portraits historiques ont été détruits et méritaient bien cependant d'être conservés. René de Tende, frère naturel de la mère de François 1er, avait été tué en combattant à côté de ce prince à la malheureuse bataille de Pavie, et honoré de Tende, son petit-fils, avait noblement refusé de faire exécuter la Saint-Barthélemy en Provence, en 1572. Mais que connaissaient les démolisseurs de 1793 à la bataille de Pavie, ni même à la Saint-Barthélemy ?
Quelques autres portraits historiques ornaient encore ces salles et ont eu le même sort que les précédents : tels que ceux de Jean Maynier d'Oppède, premier président du parlement, mort en 1558 ; d'Henri de Forbin d'Oppède, issu du précédent par les femmes, mort également premier président en 1671 ; du duc de Mercœur, créé cardinal de Vendôme en 1667; enfin celui du grand prieur Henri d'Angoulême, fils naturel d'Henri II, tué à Aix par Altovitis en 1586. Ces divers personnages avaient été recteurs de la confrérie.
Le grand-prieur d'Angoulême, gouverneur de Provence, était un ami des arts ; il possédait un riche cabinet de curiosités antiques et modernes. Il désirait vivement y réunir le bas-relief de Notre dame de pitié, dont nous avons parlé, et le demanda aux pénitents qui le lui refusèrent. Piqué de ce refus, il les quitta pour se faire agréger aux pénitents des Carmes.
Ceux-ci portaient alors l'habit noir, étant une scission des pénitents Noirs établis dans le voisinage des religieux Cordeliers. Ces pénitents avaient pris la robe noire en 1563 au lieu de la robe blanche qu'ils portaient depuis leur fondation. En 1573, quelques-uns d'entre eux, mécontents de l'élection de leur recteur, s'étaient séparés d'eux et avaient fondé la chapelle des pénitents des Carmes dans l'église des religieux de ce nom, d'où ils se transférèrent, en 1654, au lieu qu'ils occupent actuellement dans la rue du Louvre.
Voulant reconnaître l'honneur que leur faisait le prince en s'agrégeant à eux, ils quittèrent en sa faveur la robe noire et adoptèrent la couleur blanche qui est la leur depuis lors.
On fit à cette occasion la chanson provençale que nous allons rapporter quoique assez mauvaise. Mais comme monument historique, elle offre quelque intérêt, attendu qu'elle fut chantée pendant plusieurs années dans les rues d'Aix sur un air connu à cette époque: